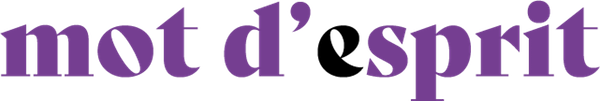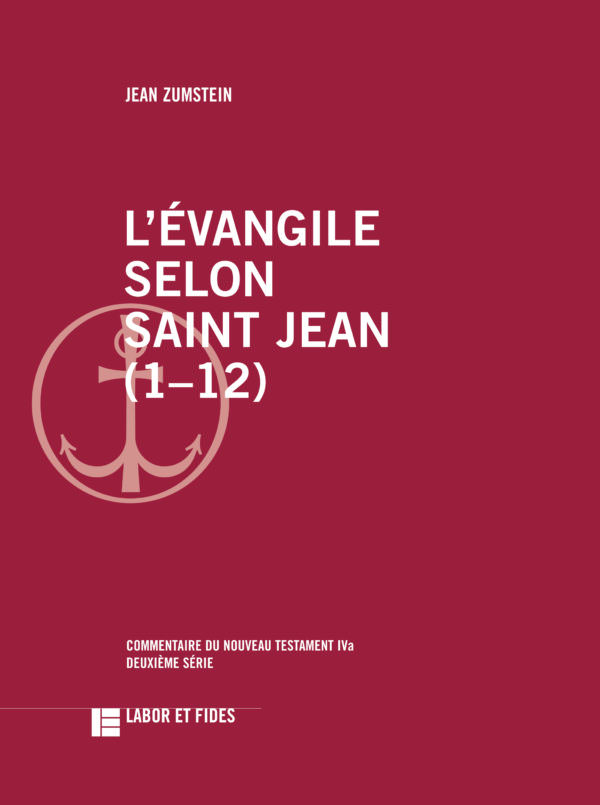Ou plutôt merci aux deux Jean. Premièrement à Saint Jean d’avoir écrit son Evangile (un best-seller, rappelons-le) et d’avoir ainsi diffusé la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. Ensuite au théologien Jean Zumstein d’avoir écrit un commentaire de cet Evangile (un futur best-seller, n’en doutons pas) dont le tome 1 vient de paraître (éd. Labor et Fides ; le tome 2 est déjà paru en 2007). Venu le 5 mai 2014 au Sycomore, dans le cadre de Un auteur, un livre, Zumstein nous a offert une riche soirée en répondant aux questions posées par Virgile Rochat puis par le public.
Ses propos m’ont touchée pour plusieurs raisons.
Lire le commentaire d’un livre biblique, c’est bénéficier d’un ensemble d’explications destinées à faire mieux comprendre au lecteur actuel le texte ancien, le contexte dans lequel il a été écrit, pour quels lecteurs, et aussi comment ce texte a été lu et reçu au cours des siècles. Or Zumstein pose que l’Evangile de Jean est lui-même un commentaire et une interprétation des actions du Christ. L’évangéliste a un projet théologique précis : les signes « qui sont ici ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est Christ, fils de Dieu, et qu’en son nom, confiants, vous ayez la vie » (Jean 20, 31). Il donne un sens à la vie et à la personne de Jésus en précisant son identité. Dans l’Ancien Testament, Dieu disait « Je suis ». Dans Jean, Jésus reprend cette parole en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie». L’originalité de l’évangéliste Jean, qui relate bien moins de miracles que les synoptiques, est de développer longuement chaque récit et de présenter en détails les réactions des personnages. Ainsi, dans la guérison de l’aveugle-né (Jean 9), l’ancien aveugle répond aux questions réitérées des pharisiens en disant chaque fois ne pas savoir comment le miracle s’est produit, mais en confessant sa foi en Jésus. Le lecteur de l’Evangile de Jean n’est-il pas appelé lui-aussi à prendre position face à Jésus ? Va-t-il comme l’aveugle guéri voir clair en recevant Jésus, la lumière du monde, ou alors pinailler sur le pourquoi du comment de cette guérison?
D’autre part, comme traductrice, j’ai compris les obstacles que Zumstein a pu rencontrer en traduisant l’Evangile de Jean du grec en français, avec le risque de trahison que cet exercice comporte. L’auteur a d’ailleurs choisi de laisser certains mots en grec (exemple : Logos, qu’on ne peut traduire qu’approximativement par la Parole ou le Verbe).
Férue d’histoire, j’ai aimé l’insistance de Zumstein sur un des buts que l’Evangéliste donne à son livre : faire mémoire de la vie de Jésus. J’ai goûté aussi sa prudence concernant l’exactitude des faits et des paroles relatés, sachant que toute histoire racontée par un auteur est une interprétation (exemple de deux biographies du général Guisan qui seront très différentes même si leurs auteurs disposent des mêmes sources historiques).
Passionnée par la personne du Christ, j’ai mieux compris le mystère de sa relation à Dieu grâce à l’image employée par Zumstein, celle de l’ambassadeur. Envoyé du Père, Jésus agit et parle comme l’ambassadeur d’un roi auprès d’un autre pays. Or à la manière du Proche-Orient de l’époque de Jésus, si l’ambassadeur parle, c’est le roi qui parle; s’il agit, c’est le roi qui agit. Donc si Jésus est là avec les hommes, c’est Dieu lui-même qui est là. Et ce rôle d’ambassadeur, nous les croyants sommes aussi appelés à le jouer : « Soyez en paix…Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20, 21).
Je me réjouis donc de me plonger dans le commentaire de Jean Zumstein pour relire la Bonne Nouvelle avec un regard neuf, pour recevoir les paroles de Jésus et me fier toujours davantage à cette Parole par excellence.
Annelise Rigo