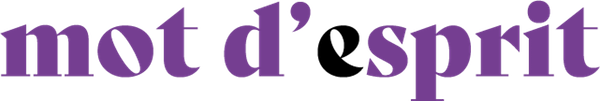Un passage de l’apôtre Paul m’a amusé. Il écrit (1 Co. 16,9) : Je resterai à Ephèse jusqu’à la Pentecôte, car une porte s’y est ouverte toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux ! Qu’est-ce que Paul veut insinuer avec cette remarque : et les adversaires sont nombreux ? Serait-il un apôtre tellement agressif qu’il chercherait la bagarre, considérant la présence d’adversaires comme une raison supplémentaire pour poursuivre son activité à Ephèse ? Dans d’autres traductions, nous lisons : bien que les adversaires soient nombreux. Cela voudrait dire que Paul craint la présence de nombreux adversaires, mais montre cependant assez de courage pour poursuivre sa mission. La première traduction colle plus au texte : à mon avis, Paul apprécie positivement la présence d’adversaires ; s’affronter avec eux lui semble faire partie de sa mission ! J’aimerais partager avec vous les réflexions qu’a suscitées en moi cette prise de position.
Mais auparavant, il s’agit d’établir une distinction entre ennemis et adversaires. Un ennemi (inimicus) est quelqu’un d’hostile. Il y a de son côté une opposition et même une fermeture radicales. Entre lui et nous, il y a un fossé ou un mur. Avoir un ennemi nous empêche de dormir ; car nous nous demandons ce qu’il va entreprendre contre nous. Mais nous culpabilisons aussi face à lui, nous demandant quel tort nous avons pu lui causer, nous faisant du souci pour ne pas élargir le fossé qui nous sépare ? Comment sortir de cette situation bloquée ?
Par contre, un adversaire (adversus, qui est dans le camp opposé) est un opposant tactique. Il n’est pas hostile à ma personne, mais il conteste l’un ou l’autre des points que je défends. L’adversaire invite à la discussion, au dialogue. Même si nos positions peuvent rester finalement incompatibles, l’adversaire manifeste de l’intérêt pour le problème en jeu, il me pose des questions, il m’oblige à préciser, à approfondir mon point de vue, il peut m’en faire changer. L’adversaire m’apprend quelque chose. Nous avons besoin d’adversaires ; c’est donc une grave erreur que de confondre sans autre nos adversaires avec des ennemis, même si c’est difficile !
La question que je désire soulever est de savoir si, aujourd’hui, notre Eglise a, ou même mérite, d’avoir des adversaires. Nous avons la chance de vivre en paix, le canton nous accordé un statut et un financement ; d’une manière générale, non seulement on nous tolère, mais on nous apprécie. La tentation est proche, à cause de cela même. Elle peut prendre au moins trois formes, qui nous évitent d’avoir des adversaires. 1) Notre Eglise, qui apprécie favorablement notre société démocratique et humaniste se contente de lui apporter la caution métaphysique et spirituelle qui lui manque, tout en restant neutre à son égard. Ne la critiquant pas, l’Eglise n’aura pas d’adversaires. 2) Ou, au contraire, touchés par les dégâts psychiques et spirituels que commet cette société matérialiste, alertés par les clivages injustes engendrés par la domination du tout-à-l’économie, les chrétiens se concentrent sur les blessés à guérir, les brèches à colmater, les marginaux et les laissés-pour-compte à aider. Mais sans rien dire ! Elle n’aura pas d’adversaires. 3) Troisième tentation considérée : L’Eglise est une communauté ; elle pourrait donc vivre en communauté fermée, avec un Evangile fonctionnant comme une charte interne. Dans ce cas de figure, les adversaires existent, mais ils restent en dehors !
Je me dis que si nous ne prenons pas en compte les adversaires, si, par peur, nous ne nous confrontons pas à eux, si nous restons muets, nous risquons, en tant qu’Eglise, en tant que paroisse, d’avancer sur de fausses pistes, qui ne correspondent pas au contenu de l’Evangile. Notre politique pastorale sera mal orientée. Finalement, l’apôtre Paul n’avait-il pas de la chance d’avoir de nombreux adversaires ? Et notre malchance n’est-elle pas d’avoir affaire à des quantités d’indifférents ? Avec des indifférents, c’est clair, on ne peut aller bien loin. Cependant, n’y a-t-il pas parmi ceux que nous croyons indifférents, des adversaires potentiels ? Et notre tâche ne serait-elle pas de discerner chez ceux que nous estimons indifférents les adversaires dont nous avons besoin ? Il ne s’agit pas d’en venir aux mains, ni d’inventer des conflits artificiels, surtout pas d’échafauder des stratégies agressives. Comme chrétiens, nous sommes formés par le récit évangélique ; ce récit nous place devant Dieu, dans la création, il nous adresse au Christ qui s’est donné pour nous, il nous constitue responsables du monde dans la liberté acquise. D’autres personnes sont formées par d’autres récits, ou elles le comprennent différemment. Il s’agit de confronter les récits qui nous forment, de les interroger, en référence à la Parole de Dieu. Notre but n’est pas de rallier les adversaires à notre point de vue, de les enfermer dans notre propre récit ; mais, dans le dialogue, nous modifions conjointement nos récits et nous approchons ensemble du Dieu qui nous parle. Les adversaires nous permettent de sortir de notre tour d’ivoire.
L’actualité, tragiquement, nous montre comment des personnes ou des Etats adversaires, incapables de se parler, deviennent des ennemis, jusqu’à entrer en guerre. Après bien des massacres, ils constatent qu’il est impossible de continuer ainsi. Il faut négocier, c’est-à-dire quitter, petit à petit, le statut d’ennemis pour redevenir de simples adversaires. Et il n’est pas impossible, qu’après des décennies, on devienne des amis ! Quand Jésus, dans le Sermon sur la Montagne, nous demande d’aimer nos ennemis, n’a-t-il pas en vue cette possibilité, qui est pour lui une exigence ? Car il sait que, même avec notre pire ennemi, nous avons un point commun : nous sommes l’objet de l’amour de Dieu, qui nous porte, qui nous supporte, qui nous appelle. Or, si nous avons ce point commun avec notre ennemi, c’est qu’au fond, il n’est que notre adversaire ! Un être auquel nous sommes appelés à nous confronter de manière positive .
Dans le sens que nous venons d’explorer, nous ne pouvons donc que souhaiter, – à notre Eglise comme à nous-mêmes – d’avoir peu d’ennemis, mais beaucoup d’adversaires.
René Blanchet