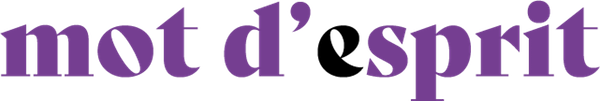L’Insensé de Nietzsche l’annonçait : « Où donc est Dieu ? Je vais vous dire où il s’en est allé… : nous l’avons tué…, vous et moi ». Ce cri qui retentit jadis dans tout l’Occident chrétien fut loin d’être l’annonce triomphante d’une victoire. Il plongea les humains dans l’abîme : « Où allons-nous nous-mêmes, maintenant, loin de tous les soleils ? » Reconnaître ce double constat exige courage et lucidité. Et du temps. Aujourd’hui nous y sommes et on en parle… Mais de quel Dieu Nietzsche proclame-t-il la mort ?
Enjeux et horizon
Cette question est cruciale tant pour les Eglises chrétiennes que pour les croyants qui les fréquentent encore. Depuis plusieurs décennies déjà, actualisant en cela un vaste mouvement de l’histoire de la religion en Occident, nous assistons au rapide délitement de la « chrétienté », à son agonie et à sa fin. Comment donc comprendre ce qui se passe ? S’agit-il d’une sortie progressive de toute forme de croyance religieuse (comme d’aucuns l’ont prédit de manière rapide et téméraire…) ou en va-t-il, prioritairement, de la fin d’une certaine forme de christianisme ? Dans cette seconde hypothèse (qui sera la nôtre), quel est donc le christianisme qui se meurt ? Et vers quelle forme de religion nous dirigeons-nous ? Allons-nous vers un christianisme arc-bouté sur lui-même, campant sur des positions absolues et intransigeantes ? Ou vers un christianisme ouvert, renouvelé, re-formé, voire franchement « non religieux », aux prises avec les défis actuels et les questions de tous ?
Sur ce blog, tout au long des mois qui viennent, nous tenterons de démêler l’écheveau et de savoir de quoi on parle. Qu’entend-on par « chrétienté » ? Quels sont ses fondamentaux, ses points d’appui, les ressorts de sa pensée ? Et quelle(s) représentation(s) de « Dieu » sont à l’œuvre dans un tel christianisme ? Nous croiserons alors des termes lourds de sens ; nous parlerons de « métaphysique », de « théisme », de « sécularisation et de laïcité », de « spiritualité, de mystique et d’avenir de la religion » ; de l’Evangile aussi et de ce qui survient, aujourd’hui encore, sous les mots « Dieu », « Christ », « Eglise »…
Pour l’heure, larguons les amarres et commençons le voyage… avec le mot « Chrétienté ».
Vous avez dit « Chrétienté » ?
La notion de « Chrétienté » est une construction des historiens et des penseurs modernes pour tenter de caractériser les temps qui nous ont précédés. Il serait donc trompeur de réduire cette notion à une période déterminée (par exemple du 3e au 14e siècle), puisque nombre de ses traits, de ses ressorts sont à l’œuvre à travers les âges et de nos jours encore. Pourtant, entre le christianisme de l’Antiquité, du Moyen âge, des Temps modernes et notre christianisme actuel, s’il y a nombre de points communs, plusieurs différences, ruptures et écarts sont survenus qu’il s’agit de repérer et de valider.
Parmi les caractéristiques principales de la « Chrétienté », on notera d’abord le lien fort entre religion et politique. On entend par là le passage progressif du christianisme comme « écoles de sagesse » (2e siècle), comme « mouvements communautaires » vers une« religion institutionnalisée », c’est-à-dire vers une socio-structure juridique et politique, dotée de critères de régulation des traditions (Canon des écritures), de la vérité (règles de foi, doctrines et dogmes) et de l’institution (succession apostolique, organisation hiérarchique, discipline). On parlera également de « Chrétienté » à partir du moment où le christianisme, de religion illicite, deviendra religion licite (sous l’empereur Constantin, édit de Milan 313), puis religion d’Etat et d’Empire (sous Théodose). Cependant, la « Chrétienté » correspond également à des postures intellectuelles, des schèmes de pensée, des conceptions du monde dont il est possible de présenter les contours principaux.
Selon le philosophe italien Gianni Vattimo, la « Chrétienté » désigne les différentes époques du christianisme qui correspondent au Dieu premier-moteur d’Aristote, au Dieu-fondement de l’être, au Dieu-suprême horloger et architecte du rationalisme des Lumières, au Dieu moral de la dogma-discipline. Comme on le sait, le christianisme reprendra à son compte, tout en l’adaptant, le dispositif métaphysique grec. Il s’inspirera également de la représentation théiste du divin qu’il trouve dans les religions et cultures qui l’ont précédé. Le christianisme fonctionnera alors comme clé de voûte rationnelle et normative valable aussi bien pour les individus que les sociétés ; il devient ce à partir de quoi, les personnes et les collectivités trouvent leur identité et leur raison d’être. Il fait désormais partie des mentalités et sous-tend les structures de la société. Plus vraiment questionné ou interpellé, il fonctionne comme le mythe porteur d’une culture, d’une nation, d’une civilisation.
Au terme de cette très brève présentation, une foule de questions surgissent. Parmi elles, les trois suivantes que je partage avec vous :
- Quels ont été les apports (en + et -) de la chrétienté à la civilisation occidentale ?
- Comment réagir à cette citation du philosophe danois Sören Kierkegaard : « Toute la chrétienté n’est autre chose que l’effort du genre humain pour retomber sur ses pattes, pour se débarrasser du christianisme (= de la foi chrétienne) » ?
- Des ruines de notre « civilisation chrétienne », quels nouveaux visages du christianisme et de la spiritualité chrétienne vont-ils pouvoir émerger ?
Jean-François Habermacher
Pour en débattre, n’hésitez à rejoindre Le Club Cèdres, mardi prochain, 16 septembre, au Chemin des Cèdres 5, DM-échange et mission, 1004 Lausanne (18h30-21h30). Inscriptions par courriel (info@cedresformation.ch) ou par téléphone 021 646 37 41. Entrée gratuite !