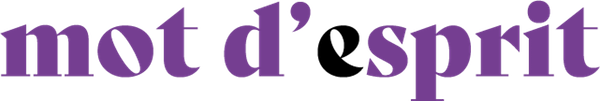Par Anne Sandoz Dutoit
Toute langue est caractérisée par sa grammaire, son vocabulaire, ses symboles et, dans bien des cas, sa littérature. De même, chaque religion peut être vue comme une langue visant à articuler, aux plans individuel et social, la composante spirituelle, que je qualifierais d’« au-delà du moi ». Cette composante, en harmonie étroite avec le corps et le psychique, permet à l’humain de développer ce à quoi il est véritablement appelé, avec ses semblables.
Toute langue est enracinée dans une ou des cultures, comme chaque religion naît et se développe en un ou des terreaux spécifiques et élabore sa vision du monde et de l’humain. Notre grammaire religieuse occidentale est judéo-chrétienne depuis plus de 2’000 ans. L’appel à devenir vraiment humain peut donc se faire entendre entre autres à travers le langage chrétien qui a marqué la vie et les productions culturelles de nombreuses générations. Cet appel, adressé à chacun-e, je le comprends comme une incitation à cultiver le lien avec une dimension qui à la fois me dépasse et me fait grandir de l’intérieur, comme un encouragement à développer tous les aspects de ma personne : physique, psychique, relationnel et spirituel. Sans cela, je suis amputée d’une part de moi-même. De plus, cette interpellation ne tend pas seulement à un mieux-être individuel, elle est encore exhortation à assumer mes responsabilités vis-à-vis de mon environnement naturel et social, pour le bien commun.
Textes bibliques, rites, traditions, édifices religieux et symboles liés au christianisme sont autant d’éléments d’une langue qui devient pourtant de moins en moins familière. Il est donc important de la (ré)apprendre et de la transmettre en l’actualisant au risque de tomber sans cela dans un analphabétisme qui peut rendre l’appel plus difficile à discerner. Comme il est nécessaire de développer un langage qui permet de dire le corps, le psychique et le social, leurs besoins et leurs maux respectifs, il est en effet indispensable de pouvoir articuler ce « lieu du manque » en moi qui aspire à autre chose, à du plus grand. D’où l’importance d’offrir à tous non pas une foi « clé en main », mais des outils pour partir en quête de leur part spirituelle et la faire grandir. Je ne suis toutefois en mesure de transmettre qu’une langue religieuse que je connais bien, inséparable d’une culture où j’ai mes racines. Quant aux autres langues, je peux en reconnaître la richesse et chercher à les comprendre, mais je ne m’y sentirai jamais aussi à l’aise que dans ma langue maternelle. Alors autant puiser dans les ressources qui sont les miennes pour tenter d’éveiller chez d’autres la curiosité et le goût du spirituel.
Sous quelle forme et à travers quels signes se laisse découvrir la transcendance qui, dans la grammaire qui est la mienne, se nomme Dieu de Jésus-Christ, ne m’est pas d’emblée accessible. Il n’en résulte pas pour autant que d’autres grammaires ne puissent pas également servir à accueillir, dire et vivre son message. Il n’y a pas de hiérarchie des langues et c’est aux fruits que se reconnaît la réponse donnée à l’interpellation. Le contact entre langues religieuses a de surcroît le potentiel d’enrichir chacune et de favoriser des remises en question réciproques, parfois salutaires.
Face aux défis environnementaux, migratoires et sociaux de notre époque, il est urgent de trouver des pistes pour un mieux-vivre ensemble sur la Terre où nous cohabitons. Une quête commune de valeurs est requise. Le dialogue interreligieux, auquel associer les athées et les agnostiques, peut y contribuer. Un tel dialogue implique cependant que chacun-e soit à même de rendre compte de sa vision du monde et de l’Homme, – d’où l’importance de connaître aussi sa propre grammaire spirituelle -, et de saisir les enjeux des autres grammaires, ce qui ne va pas nécessairement de soi ! Apprendre à s’écouter les uns les autres, que nous pouvons fonder comme chrétiens notamment dans l’apprentissage de l’écoute de l’Autre, prend ici toute sa valeur. Par ce dialogue, cherchons à devenir ensemble plus véritablement humains, à la fois enracinés dans nos identités spécifiques et ouverts aux autres. La conscience de notre interdépendance et des responsabilités qui en découlent en sortira certainement vivifiée.