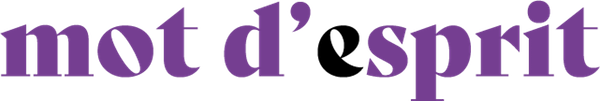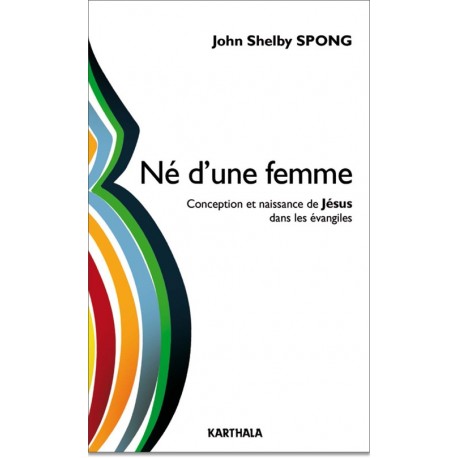« Né d’une femme » est le deuxième livre de John Shelby Spong qui a fait l’objet d’une traduction en français ; la version anglaise date de 1992. On se souvient du premier : « Jésus pour le XXIe siècle » paru en 2013 et réédité en 2015, également aux Éditions Karthala.
A la base de ce nouveau volume, nous trouvons un questionnement relatif aux origines bibliques et plus particulièrement chrétiennes de la soumission de la femme dans la société : « La lecture littérale de la naissance virginale sert à maintenir les femmes dans un statut de citoyen de seconde zone », relève l’auteur. A partir de là, le thème central que Spong développe ici est la conception et la naissance de Jésus dans les Évangiles.
Comme pour ce qui concerne « Jésus pour le XXIe siècle », le lecteur peut ressentir l’impression que l’ancien évêque de l’Église épiscopalienne des États-Unis enfonce, à longueur de pages, des portes ouvertes depuis quelque trois cents ans : le rejet des dérives littéralistes remonte pour le moins au siècle des Lumières. Il faut souligner que Spong, élevé dans la foi chrétienne traditionaliste, ne s’est que progressivement libéré de sa formation ecclésiastique sur laquelle on peut s’interroger, à bon droit, puisqu’il affirme avoir découvert tardivement les mythologies comparées, l’exégèse libérale, voire l’œuvre de Carl-Gustav Jung : « J’ai exploré différents aspects de cultes rendus à Isis, Cybèle, Artémis et Diane, que je ne connaissais presque pas. J’ai rencontré la vierge noire. J’ai cherché à séparer la vierge Marie du mythe (…). Enfin, j’ai lu avec attention les écrits de Carl G. Jung (…) à la recherche de la manière dont les concepts de masculin et féminin ont été liés à l’histoire psychique de l’humanité ». Et, quelques pages plus loin, il précise : « Beaucoup d’histoires dans les mythologies du monde sont par exemple comparables à des passages familiers de la tradition chrétienne » comme s’il existait encore quelqu’un qui pût en douter.
La lecture qu’il propose des « Évangiles de l’enfance », n’a donc rien de révolutionnaire, loin s’en faut. Ce n’est que depuis quelques décennies que Spong constate que les textes bibliques, ceux-ci comme les autres, ne relèvent pas de l’histoire factuelle, mais s’inscrivent dans des universaux mythologiques. La lecture littéraliste induit en effet des contresens intellectuellement irrecevables, produit des doctrines à partir d’identités inacceptables de Jésus, de Marie, de Joseph, et engendre des conséquences lourdes sur la soumission et l’infantilisation de la femme. Il est donc urgent pour les hommes et les femmes de la modernité, formés à la pensée critique, de décrypter les textes bibliques pour y découvrir le sens symbolique à l’aide de clés appropriées, afin de retraduire la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu en termes d’aujourd’hui. La mythologie chrétienne, précise l’ancien évêque épiscopalien, n’empêche pas la foi en Jésus de Nazareth reconnue comme source de salut. Et, constatant comme tout un chacun le déclin de la fréquentation des Églises historiques, il esquisse la parade lors d’une conférence en juin 2015 à l’Oratoire du Louvre : « Si les gens perçoivent que la seule manière de comprendre les récits bibliques est de se fier littéralement aux textes, ils ne croient pas en l’histoire chrétienne. D’ailleurs, la plupart des jeunes ont renié l’Église, car ce qu’elle raconte n’a aucun sens pour eux.»
Spong ne donne pas seulement l’impression, naïve et touchante, de réinventer la roue, mais aussi de prendre une revanche sur son propre passé théologique et en particulier l’aveuglement dans lequel l’avait plongé sa formation académique. En filigrane, le lecteur semble entendre une confession de Spong en ces termes : « Comment ai-je pu adhérer naguère à une lecture littéraliste des Écritures en dépit de mes compétences académiques et naviguer, théologiquement, au même niveau que les fondamentalistes dépourvus de ces compétences ? Et l’évêque émérite souligne que l’approche littéraliste des Écritures caractérise des auteurs incapables de pensée abstraite, des chrétiens somme toute insécurisés et craintifs. « L’exégèse biblique libérale et l’exégèse biblique conservatrice n’existent pas, souligne Spong, ce qui existe, c’est l’exégèse biblique compétente. Le but de toute discipline académique est de rechercher la vérité. Lorsque la recherche est consacrée à défendre des positions d’un autre temps, elle cesse d’être de la recherche et elle devient rien de plus que de la propagande.
Les récits de naissance dans la Bible ne sont pas des histoires littérales. Ils sont des tentatives d’expliquer mythologiquement une expérience réelle, c’est-à-dire le fait que le saint a été rencontré dans l’humain. Qui que ce soit qui traite la naissance virginale comme littéralement vraie ou exacte biologiquement n’a simplement plus aucune crédibilité intellectuelle. »
« Né d’une femme », comme « Jésus pour le XXIe siècle » sont des ouvrages agréables à lire, tant par la clarté et la simplicité du langage accessible au plus grand nombre, que par la solidité documentaire qui caractérise les productions de ce théologien qui s’inscrit sans aucun doute parmi les plus médiatisés du moment.
Théologiquement parlant, Spong n’apporte à l’évidence rien de neuf, si ce n’est l’insistance avec laquelle il entend démontrer que la survie du christianisme est liée au combat à jamais inachevé contre l’exégèse littéraliste et le concept fondamentaliste de l’inerrance biblique qui lui est indissociablement lié.
John Shelby Spong, « Né d’une femme », Ed. Karthala, Paris, 2015, 256 pp.
Jacques Herman