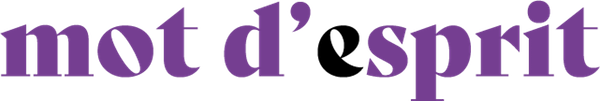Rien n’est plus frappant, pour un chrétien d’Europe occidentale, que la ferveur religieuse en Roumanie. Les églises sont bondées jusqu’à déborder, parfois, sur les trottoirs. On achète des bougies par paquets puis on les plante dans des abris particuliers : pour les morts à gauche, pour les vivants à droite. On fait la file pour poser les lèvres sur les icones. On se signe devant les innombrables croix le long des chemins. Des tonneaux d’eau bénite sont à disposition à l’extérieur des églises. La pratique religieuse imbibe la vie quotidienne. Toutes les classes sociales, hommes et femmes, jeunes et vieux, sont concernées par une foi chrétienne sans doute aussi vivace que l’était le catholicisme romain au moyen âge.
Des 21 millions d’habitants, 85% se déclarent orthodoxes, 5% catholiques romains, et 5% protestants. On dénombre environ 50.000 musulmans et 20.000 personnes de confession juive.
L’Eglise orthodoxe s’est développée de manière exponentielle depuis 1990, à la faveur de la fin du régime de Ceausescu. Elle est aujourd’hui omniprésente, sur tout le territoire, de Timisoara à Constanta, de Bucarest à Baia Mare. Près de 5000 églises on été construites depuis la révolution de 1989. Chaque mois, une dizaine de nouveaux lieux de culte surgissent dans le pays, et un édifice religieux gigantesque est en construction dans le parc qui se situe derrière le palais du parlement, de quoi faire se retourner dans sa tombe le dictateur mégalomane.
Outre les « skites » (ermitages), on dénombre plus de trois cents monastères dont beaucoup sont des véritables chefs d’œuvre de l’art religieux.
Le nombre des lieux de culte par habitants en Roumanie dépasse très largement ceux de la « Bible Belt » au sud-est des Etats-Unis.
La dévotion religieuse roumaine ne peut manquer de nous interroger. Elle rappelle, d’une certaine manière, la ferveur observable dans certaines dénominations évangéliques. Du reste, l’Eglise orthodoxe roumaine ignore totalement le courant théologique libéral et la liturgie, longue et complexe, répond pratiquement à elle seule aux besoins spirituels des fidèles.
Au lendemain de la chute du communisme, la population a renoué les liens avec des pratiques qui, jusque là, avaient été mises sous le boisseau. Elles n’ont cessé de se développer. Et le touriste chrétien occidental y découvre une ferveur qui ne cesse de l’interroger.
Jacques Herman
Image: Klearchos Kapoutsis CC by