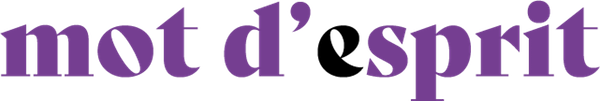L’EUCHARISTIE
Réalisée par des participants du programme 2024-2025,
une analyse d’un chapitre du livre de Marie Balmary,
Ce lieu que nous ne connaissons pas. A la recherche du Royaume,
Albin Michel, 2024, pages 151-154
Composé de catholiques et de réformés, le groupe compte 7 membres dont 6 présents. Après un bref tour de table, nous décidons de nous tutoyer bien que tous ne se connaissent pas.
Notre partage porte sur l’Eucharistie. Ce thème a été abordé dans d’autres chapitres, notamment celui sur le Notre Père. Le contexte culturel très éloigné du nôtre nécessite une contextualisation. Chacun perçoit des aspects différents.
M. Balmary insiste sur l’action de briser le pain, pas celle de le partager. Si le pain n’est pas divisé, cette scène resterait une simple cérémonie qui ne serait pas vraiment vivante. L’acte de rompre le pain induit une dissociation d’avec l’adoration du Saint Sacrement dans l’hostie non brisée, exposée sur l’ostensoir, selon la tradition catholique. Utiliser des verres individuels lors de la communion plutôt que de se passer la coupe, fait perdre en partie le sens de l’unité pour certains. Les paroles prononcées par Jésus « Prenez et buvez, ceci est mon sang » sont en elles-mêmes très transgressives car aucun juif n’avait le droit de boire du sang. Elles s’inscrivent dans d’autres transgressions relatées ailleurs dans les Évangiles. On voit bien ici le pas culturel à franchir par les premiers chrétiens, tous d’origine juive au début du christianisme.
Pour Zwingli, l’Eucharistie est un symbole. Il nous paraît qu’il faut être au moins deux pour pouvoir célébrer, induisant une nécessaire relation de foi. Dans certaines confessions orientales, le nombre minimum est cinq, dont obligatoirement un prêtre et un diacre. Ermite dans le désert, Charles de Foucauld disait seul la messe, en lien de Communion avec les saints, selon la théologie catholique.
L’Eucharistie pourrait être célébrée au cours d’un repas, moment où les échanges se font, comme lors de son institution. Luther parle de consubstantiation, alliant symbole et réalité. D’un commun accord, nous ne voulons pas entrer dans la polémique sur la présence réelle, mais clairement nous ne voyons pas qu’un symbole dans la Cène. Ce qui nous paraît le plus important est le geste qui signifie la relation, la fracture du pain, pas la sacralisation des espèces comme telle. Donner et recevoir est le cœur de l’Eucharistie : c’est un corps relationnel (cf. p.152-154). Elle se situe à un autre niveau que le concept de présence réelle/symbole, car ce qui traverse l’histoire, ce sont la quinzaine de personnes qui sont là ensemble à ce moment-là. « Je ne suis pas en train de me demander s’il y a présence réelle ou pas, il y a bien présence, ce signe reste actuel ».
Cette présence peut se vivre à la manière des pèlerins d’Emmaüs ou lorsque l’on met en pratique cette parole de Jésus « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux », Mt 18. Lors de la célébration eucharistique, une transformation relationnelle est à l’œuvre. Il se passe quelque chose. Entre nous. En nous. Avec Jésus vivant.
La Cène a pris des significations différentes au cours de l’histoire. Dans l’Église écossaise, l’Eucharistie était célébrée deux fois par an, pour ne pas galvauder le sacrement. Au préalable, il faut qu’il y ait rassemblement. Même sans communion aux espèces, on est transformé, car on a écouté. Dans « Ceci est mon corps », ceci est neutre. Il ne s’agit donc pas de l’enveloppe corporelle mais d’un autre corps qui ne se rapporte ni au pain ni au vin, mais à ce qui constitue un « être ensemble » : celui qui donne et celui qui reçoit le pain et le vin. Ce pain brisé, n’est pas seulement Christ présent dans ce geste, c’est moi que j’offre. Se passer le pain et le vin est une manière de renforcer la symbolique : donner, se donner, recevoir, former un corps, une alliance, une communauté. On fait passer l’amour, l’affection, le service, toujours à un niveau égal. Subtile relation entre le je et le moi, entre toi, moi et les autres, et avec le Tout Autre.
L’essentiel n’est pas la séquence « Je reçois la bonne Parole, le Corps du Christ, Amen, mais la communauté. » L’acceptation de la non-connaissance est la base de la relation. La vie est sacrée dans la mesure où je la reçois et je l’accompagne, ce qui introduit une certaine fluidité. Pas de sacralisation en soi. Catholiques et protestants ont sans doute une différence de perception sur ce sujet.
Une relation de troisième type existe entre Jésus et ses amis. Ne serait-elle pas celle espérée, lorsqu’il parle du Royaume ? Les repas de Jésus où tous sont accueillis de manière inconditionnelle n’en seraient-ils pas une ébauche (?), comme le suggère le théologien François Vouga.
Lire la vie de Jésus comme étant un sacrifice a été longtemps omniprésent, et reste encore très important chez divers chrétiens. Est-ce ainsi que sa vie nous est transmise ? Il vit pleinement l’agapè sans se laisser entraver par ses détracteurs en allant jusqu’au bout. Renoncer aurait été se renier. Mais que faire des passages bibliques qui déclarent que Jésus est « mort pour nous ? » (par exemple : Rm 5,8 ; 2 Co 5,14-15…). Qu’est-ce qui est essentiel ici : le sacrifice d’une victime innocente qui paie à la place des bourreaux ou l’Alliance de vie qui peut naître jusque dans la mort ? La notion de sacrifice est en effet ambivalente, elle peut faire peur ou avoir un effet libérateur. Elle peut induire une culpabilité : s’il est mort pour moi, on est lié par un contrat. Je peux me sentir forcé. Me permet-elle d’entrer dans le mystère de l’inatteignable de Dieu ?
Croire, c’est croire en l’autre. Alliance n’est pas fusion. Dans le pain brisé/partagé, un échange se produit : je reçois la nourriture de l’autre et dans le même mouvement je me donne aussi. Ainsi, la fracture/partage du pain fait la communauté qui célèbre comme prêtre. Pour pouvoir établir la relation, il faut faire place. À chacune, à chacun. En amitié de cœur, comme Montaigne et La Boétie. Dans l’agapè entre Jésus, les autres et moi pour construire le Corps du Christ qui est son Église.
Le vin partagé peut-il se comprendre comme signe de l’Alliance ? La communauté s’incarne dans la dimension horizontale de nos vies ; et l’alliance revêt un caractère vertical.
Hugues de Lagarde, rédacteur, en collaboration avec Monique Bassin, Christophe Büchi, Cynthia Defago, Pierre-André Diserens, Alain Cauderay, Eva Brunisholz, Marc-E. et Anne-Marie Diserens.