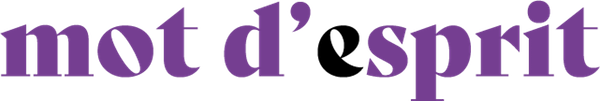Image: Paul Véronèse : Les noces de Cana, le plus grand tableau du Louvre
LES NOCES DE CANA
Réalisée par des participants du programme 2024-2025, une analyse d’un chapitre
du livre de Marie Balmary, Ce lieu que nous ne connaissons pas. A la recherche du Royaume,
Albin Michel, 2024, pages 17–24
Jean 2, 1–11
1 Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là.
2 Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples.
3 Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
4 Mais Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore venue. »
5 Sa mère dit aux serviteurs : « Quoi qu’il vous dise, faites-le. »
6 Il y avait là six jarres de pierre destinées aux rites juifs de purification ; elles contenaient chacune de deux à trois mesures.
7 Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau ces jarres » ; et ils les emplirent jusqu’au bord.
8 Jésus leur dit : « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent,
9 Et il goûta l’eau devenue vin – il ne savait pas d’où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l’eau -, aussi il s’adresse au marié
10 et lui dit : « Tout le monde offre d’abord le bon vin et, lorsque les convives sont gris, le moins bon ; mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant ! »
11 Tel fut, à Cana de Galilée, le commencement de signes de Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
LE RÉCIT
Le récit se situe après le baptême de Jésus et la rencontre des premiers disciples.
1. Introduction
Comment comprendre ce récit des noces de Cana ? De l’eau changée en vin ? Comment cela est-il possible ?
Pour Balmary, l’évangéliste Jean nous fait entrer dans la dimension de la relation de confiance.
1.1. La pensée de C. Pedotti
Pour Christine Pedotti (1) les miracles de Jésus n’ont causé de difficulté à personne pendant des siècles. Et à l’heure actuelle c’est devenu un immense problème. Et d’ajouter que si on raisonne par le : est-ce scientifiquement possible, on se trouve devant une impasse.
Toujours pour C. Pedotti, il faut partir du postulat que les évangélistes sont sincères et ce qu’ils disent est utile.
L’Évangile de Jean est écrit par une communauté chrétienne dite « communauté johannique » à la fin du 1er siècle de notre ère, en Syrie, appuyée sur le témoignage plus ou moins direct d’un ou plusieurs disciples de Jésus.
1.2. Thèmes mis en évidence par M. Balmary
Marie Balmary met en évidence 2 thèmes :
• La notion de toute-puissance (verset 5)
• La transformation de l’eau en vin (versets 7 à 9)
Dans ce texte de Jean, avant de reprendre les éléments (la notion de toute-puissance) du verset 5, je voudrais aborder la transformation de l’eau en vin relatée aux versets 7 à 9.
2. Les miracles
Les Évangiles relatent 37 miracles de Jésus. Quel sens peuvent-ils avoir encore aujourd’hui ?
Jean n’utilise pas le mot « miracle » mais « signe – semeion ». Jésus fait signe et par là-même indique sa préoccupation de l’autre, passant du monde de la connaissance au royaume relationnel.
Jésus ne fait pas des miracles pour lui-même. Marie Balmary reprend :
- Les tentations au désert : si Jésus faisait un miracle comme le lui demande Satan (changer des pierres en pain ou se jeter du haut du Temple), il le ferait seulement pour lui-même. « Si tu es le fils de Dieu », prouve-le en faisant ce qui te mettra au-dessus de tous les autres, fils d’un dieu qui régirait les lois du monde pour toi seul.
- Le moment de la mort de Jésus. Il ne descend pas de la croix comme certains le demandent. Le Christ ne fait pas un miracle seulement pour lui-même, sans l’autre et contre l’autre. Contre ceux qui l’ont jugé et condamné, contre ceux qui ricanent. Il refuse d’être le fils d’un dieu omnipotent auquel, ensuite, les hommes croiraient pour leur perte.
Jésus a pour ambition de servir son peuple et l’humanité en leur indiquant le chemin pour accéder à cette filiation divine, la filiation n’étant pas la maîtrise.
Jésus, en restant mortel, en demeurant de notre côté, continue jusqu’au bout à déjouer le piège de Satan. Il témoigne contre l’idole, le prince de ce monde. Il nous garde en présence du dieu des vivants, « Notre Père » à tous qui seul peut ressusciter ses fils.
3. La transformation de l’eau en vin
Pour aborder ce texte, il faut oublier le miracle de l’eau changée en vin, pour aborder la notion de l’eau, source de vie.
Jean 2, 7-9 : v. 7 Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau ces jarres » ; et ils les emplirent jusqu’au bord.
8 Jésus leur dit : « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent,
9 Et il goûta l’eau devenue vin – il ne savait pas d’où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l’eau -, aussi il s’adresse au marié…
Pour Marie Balmary, les serviteurs savaient qu’ils mettaient de l’eau dans les jarres et que le maître de maison goûtait de l’eau. Mais quelle eau ? Car c’est bien de l’eau que les serviteurs ont puisé.
Comment ces serviteurs ont-ils fait confiance à Jésus pour remplir ces jarres d’eau et oser aller l’apporter au maître du repas ?
Les serveurs acceptent de faire confiance à qui leur fait confiance. Cette eau ne devient vin que lorsqu’elle est portée à l’autre, ici le maître du repas puis le marié. C’est l’eau donnée avec confiance qui devient vin, non pas l’eau stockée dans les jarres : le vin apparaît dans l’eau portée à autrui, l’eau entrée dans la relation, porteuse du désir de vin. C’est le vin de la confiance.
Je fais un lien avec la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, relatée dans Jean 4,7-31
Jésus, fatigué du chemin, s’assoit au bord du puits de Jacob en Samarie. C’était la sixième heure (soit midi). Jésus demande de l’eau à une femme venue puiser de l’eau. Elle est étonnée, surprise, par la demande de Jésus : un Juif qui demande à boire à une femme et de surplus une Samaritaine. Et Jésus de lui retourner la question : « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : « Donne-moi à boire » c’est toi qui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive ».
Et Jésus de faire un lien avec l’eau du puits, qui n’étanchera pas la soif définitivement, et l’eau qu’il donne et qui deviendra une source jaillissant en vie éternelle.
4. La notion de toute-puissance
La traduction de nos Bibles dit :
Jn 2,5 : Sa mère dit aux serviteurs : « Quoi qu’il vous dise, faites-les » ou « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Marie Balmary traduit le « Quoi qu’il vous dise par « Ce qu’il pourrait vous dire »
5 : Sa mère dit aux serviteurs : « Ce qu’il pourrait vous dire, faites-le. »
La particule an pourrait dire : « Le cas échéant, faites ce qu’il pourrait vous dire »
Le mot « Tout » a été ajouté. Il ne figure pas dans le premier texte grec, ni dans la Vulgate, ni dans les traductions comme celles de langue anglaise ou allemande. Cet ajout existe principalement dans des traductions de pays latins (Italie, Espagne, France).
Dans le texte original, il y a une particule an, qui veut dire: le cas échéant.
En prenant la traduction « habituelle », on pourrait comprendre que Marie demande une obéissance sans discussion aux serviteurs. Or, déjà au moment de la conception de Jésus, Marie n’a pas conçu Jésus seule. Elle ne succombe pas à la tentation de la toute-puissance.
Au moment de la conception de Jésus, où l’ange Gabriel lui a proposé de concevoir elle seule un fils de Dieu, Marie n’a pas dit « fiat » (qu’il me soit fait selon la Parole). Elle ne succombe pas la tentation de toute-puissance. Elle oppose un : « Comment cela sera-t-il, puisqu’un homme je ne connais pas ? ». Un autre apparaît : un esprit saint viendra… Elle ne concevra pas toute seule.
Pourquoi Marie demanderait-elle aux serveurs une obéissance totale qu’elle-même n’a pas pratiquée, même envers un messager divin ?
L’obéissance totale n’est pas du goût de Marie. Marie ne demande pas aux serviteurs d’obéir à Jésus aveuglément.
Dans l’Église, la figure de la Vierge Marie est celle qui dit toujours oui. Les prédateurs transforment Marie en une figure réclamant la soumission (Tout ce qu’il vous dira, faites-le), ce qui est très différent de l’obéissance librement consentie.
5. Questions à débattre
Ce qui pose la question: quel dieu (avec une minuscule) ou quel Dieu (avec une majuscule) ?
Un dieu (Dieu) qui règle tous les problèmes ou un Dieu qui nous donne de quoi vivre ?
Christine Waeber-Bischoff
(1)Pedotti C., Jésus, cet homme inconnu, XO Editions, Paris, 2013