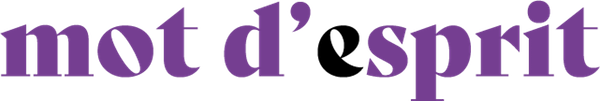MARIE BALMARY, JÉSUS GARDIEN DE LA LOI… ET DE L’AMOUR
Réalisée par des participants du programme 2024-2025,
une analyse d’un chapitre du livre de Marie Balmary,
Ce lieu que nous ne connaissons pas. A la recherche du Royaume,
Albin Michel, 2024, pages 97-108
Dans ce chapitre, Marie Balmary explore l’attitude de Jésus par rapport à la Loi ; la loi dont il s’agit ici est celle qui régit les relations de couple.
Par deux fois, les scribes et les pharisiens s’approchent de Jésus alors qu’il enseigne la foule ; ils le questionnent au sujet de son rapport à la Loi, si importante à leurs yeux…, « pour l’éprouver » dit Matthieu…, « dans l’intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l’accuser » dit Jean…
La première fois (en Jean 8, 1-10), ils amènent une femme et la placent au milieu : « Maître, lui disent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d’adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? » Jésus, se baissant, se mit à écrire (tracer des traits, dit la TOB) sur le sol. Comme ils continuaient à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ». Et, s’inclinant à nouveau, il se remit à écrire (tracer des traits) sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l’un après l’autre, en commençant par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur » et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas : va, et désormais ne pèche plus. »
Les pharisiens s’appuient sur le 6ème commandement du Décalogue : « Tu ne commettras pas d’adultère » (Exode 20, 14 ; Deutéronome 5, 18). Moïse avait reçu ce commandement de Dieu pour son peuple, au Mont Sinaï, après la sortie d’Égypte ; puis les législateurs l’avaient assorti de sanctions : les amants adultères devaient être lapidés ; le Lévitique (ch. 20) et le Deutéronome (ch. 22) énumèrent toute une casuistique de peines sanctionnant les relations sexuelles réprouvées : mort par le feu, lapidation, bannissement…, selon les circonstances ; ces peines pouvaient s’appliquer aussi bien à l’homme qu’à la femme. Soit dit en passant – et Marie Balmary le souligne aussi – où est l’homme dans notre récit ?! Si les pharisiens ont surpris la femme en flagrant délit, l’homme était avec elle !
Ces peines n’étaient, semble-t-il, déjà plus appliquées au temps de Jésus… Mais les pharisiens le somment de répondre. Marie Balmary s’interroge : « Comment sortir de la logique de la loi qui accuse, sans accuser quelqu’un d’autre ? Finalement, qui faut-il accuser du malheur : le transgresseur ou la loi ? Qui va mourir, la femme ou Moïse ? Et Jésus, que lui arrivera-t-il, quoi qu’il décide ? »
Marie Balmary se lance alors dans une digression au sujet du geste que Jésus exécute deux fois dans cette histoire : « il écrit sur la terre… qu’écrit-il ? pourquoi deux fois ? » Elle s’aperçoit que deux verbes légèrement différents sont utilisés dans le texte grec (katagrapho, puis grapho), le premier signifiant graver, le second simplement écrire. En le rapprochant du Décalogue, elle découvre (dans la traduction de la Bible en grec, la Septante) que les premières Tables de la Loi avaient été gravées dans la pierre par le doigt de Dieu, tandis que, après que Moïse les eut brisées en découvrant le peuple prosterné devant le veau d’or, il avait fallu les ré-écrire. Là, le mot utilisé n’est plus le solennel graver, mais simplement le verbe écrire, comme dans le passage de l’Évangile. Marie Balmary y voit une symétrie intentionnelle de la part de Jean, qui connaît sa Torah par cœur. Elle en déduit que Jésus, en écrivant la première fois sur le sol, montre que ce texte, gravé comme l’avaient été les Tables de la Loi par le doigt de Dieu, est exposé à être effacé par les pieds des passants ; il se contente ensuite d’écrire, comme Moïse l’avait fait, en ré-écrivant lui-même la Loi, après avoir brisé les Tables… Selon Marie Balmary, Jean voudrait montrer par-là que, aussi bien au temps de Moïse qu’à son époque, les hommes ne sont pas prêts à « entendre » la Loi de Dieu…
Marie Balmary tire de ce récit la conclusion suivante : « A cette scène qui se présentait à Jésus comme un défi, il y avait la solution « légale » : la loi demeure et supprime la femme. Il y avait la solution « libérale » : la femme demeure et supprime la loi. La sagesse invente une troisième voie : le retrait des juges et des bourreaux, la non-exécution de la sanction ». Et Jésus, au lieu de s’en aller, ajoute six mots « qui posent la loi, mais dans un nouveau rapport » : « Va, et désormais ne pèche plus ». Il renvoie la femme à sa liberté, l’invitant à recevoir désormais la loi, à entendre l’interdit… « Inventer un rapport à la loi où rien ne meurt : ni le transgresseur, ni la loi, ni celui qui se présente pour juger et sanctionner, ni même la sanction, qui peut rester non exécutée d’être applicable à tous, mais par personne. (…). Loi de l’homme libre ».
La seconde interpellation de Jésus par les pharisiens porte sur la question du divorce (Matthieu 19, 3-12). Devant la foule réunie pour écouter son enseignement, les pharisiens lui demandent : « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? » (« renvoyer sa femme » dans la traduction de sœur Jeanne d’Arc, à laquelle Marie Balmary se réfère). Jésus répond : « N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâle et femelle et qu’il a dit : « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni ! » Ils lui disent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie ? » Il leur dit : « C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes (sœur Jeanne d’Arc traduit : c’est à cause de votre sclérose de cœur qu’il vous a autorisés à renvoyer vos femmes ») ; mais au commencement il n’en était pas ainsi. Je vous le dis : Si quelqu’un répudie sa femme – sauf pour infidélité (en cas d’union illégale, dit la TOB) – et en épouse une autre, il est adultère ».
Les disciples lui disent : « Si telle est la condition de l’homme envers sa femme, il n’y a pas intérêt à se marier ». Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c’est donné. En effet il y a les eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel ; il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes ; et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du Royaume des cieux. Comprenne qui peut comprendre ! » Marie Balmary remplace pour sa part le verbe comprendre par contenir, ce qui donne : « Tous ne contiennent pas cette parole, mais ceux à qui cela est donné ». Puis : « Qui peut contenir cette parole, qu’il la contienne ! » Elle s’appuie pour cela sur le texte grec, qui utilise le verbe choreo, qui signifie contenir, avoir la place pour. Pour elle, il s’agit d’un verbe de capacité physique ; il est employé par exemple pour les jarres aux noces de Cana.
« Pas de morale possible en ce domaine, dit-elle, c’est de la physique : on ne peut reprocher à un flacon de 30 centilitres de ne pas en contenir 75 ! » La psychanalyste n’est pas étonnée d’entendre qu’il y ait des paroles qu’on n’a pas la place de contenir ; on sait aussi, d’expérience, que, à la différence des contenants en terre ou en verre, le cœur humain peut se dilater. Telle vérité qu’il ne peut entendre, telles relations dont il se sent incapable aujourd’hui trouveront peut-être plus tard place en lui. Selon Marie Balmary, c’est de cela qu’il s’agit dans ce texte.
Pour revenir à la question du mariage, Marie Balmary conclut : « Le cœur se dilate, condition indispensable pour que l’amour dure ; la relation durable est celle où deux êtres peuvent se reconnaître dans leurs propres et diverses métamorphoses. Ou bien au contraire, si les cœurs sont secs (sclérosés), ils ne peuvent se dilater, évoluer au fil des métamorphoses du conjoint et des siennes propres. Faute de pouvoir changer de désir, les conjoints ne peuvent que changer de partenaire. Cela ne dépend pas de leur maîtrise, mais de leur croissance. » « Que personne ne se sente tenu par une parole qu’il n’a pas la place de contenir, car tous ne contiennent pas cette parole, mais ceux à qui c’est donné » … Marie Balmary remercie Jésus d’avoir dit cela « en terme de possible et de don reçu… ».
Ailleurs dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit : Je ne suis pas venu abroger la Loi, mais l’accomplir » (Matthieu 5, 17). Ces deux récits des Évangiles illustrent bien cette dimension nouvelle, élargie, que Jésus entend donner à la Loi.
Quelques réflexions que m’inspire l’analyse de Marie Balmary
La loi est conçue ici comme une boussole, une direction, que Dieu a donnée aux humains pour orienter leur vie vers leur épanouissement, que ce soit dans leurs relations d’amour ou en société. La loi structure les relations sociales, dans le but de favoriser le vivre ensemble, dans la paix et le respect mutuel. Elle exprime le rêve de Dieu pour l’humain : vivre en bonne intelligence, que ce soit en couple ou dans la communauté élargie. « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » est l’expression du projet de Dieu pour les couples, appelés à durer, en faisant preuve, au fil du temps, de la souplesse qui permet aux cœurs de se dilater et de faire la place aux métamorphoses de l’un et de l’autre. Ce rêve fou, ambitieux, paraît d’autant plus fou aujourd’hui, avec l’espérance de vie qui s’allonge et voit certains couples dépasser un demi-siècle de vie commune !
Jésus rappelle ce projet de Dieu pour les couples, en invitant la femme adultère à « ne plus pécher », à accueillir l’interdit, à respecter le 6ème commandement gravé par le doigt de Dieu dans les Tables de la Loi sur le Sinaï. Il invite par ailleurs les couples à « ne pas séparer ce que Dieu a uni ». Mais dans l’un et l’autre cas, il ne condamne pas celui, celle qui ne parvient pas à « contenir » le projet de Dieu ; il fait preuve de cette compassion qui caractérise le Créateur à l’égard de sa créature, dont il connaît la fragilité ; son propos n’est pas d’enfermer l’homme, la femme, dans un carcan de règles à observer ; ils ont été créés pour la vie. Comme les autres commandements, « Tu ne commettras pas d’adultère » est exprimé dans ce temps verbal de l’inaccompli qui – comme l’a relevé Geneviève Frei en évoquant l’exigence « Soyez parfaits comme votre père céleste est parfait » – invite à tendre vers, sachant qu’il s’agit d’une « finalité annonciatrice de changement », non d’un but, d’un résultat à atteindre.
La loi est faite pour l’homme, pour le conduire vers une vie bonne ; ce n’est pas l’homme qui est fait pour la loi ; ainsi, s’il ne parvient pas à contenir la loi, une voie reste possible vers la vie, la mort ne tombe pas comme un couperet…. C’est sans doute dans ce sens que Marie Balmary présente Jésus comme gardien de la Loi … et de l’amour, en tête de son chapitre.
Si les conjoints ne parviennent plus, au fil du temps, à laisser leur cœur se dilater pour adapter leur relation aux métamorphoses de l’un et/ou de l’autre, ils ne seront pas condamnés à rester en couple, confrontés à une sorte de « mort intérieure ». On sait bien vers quelles frustrations le choix de rester malgré tout peut conduire, vers quel désarroi, vers quel désert affectif, qui appelle son lot de tristesse, de dépression, quand ce n’est pas la guerre ouverte, le dénigrement, le mépris, la violence… Jésus connaît bien le cœur de l’homme, capable de haïr autant qu’il a su aimer…
Nos législations occidentales ont suivi l’évolution des relations de couple. L’adultère n’est plus considéré comme un délit, qui appellerait des sanctions pénales. Il n’est même plus un « motif sérieux » au sens de l’art. 115 du Code civil pour obtenir le divorce, lorsque le conjoint infidèle ne consent pas au divorce (art. 111, 112 CC) ou que les conjoints ne vivent pas séparés depuis deux ans au moins (art. 114 CC). Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code civil, le 1er janvier 2000, la quasi-totalité des divorces sont prononcés sur requête commune des conjoints ou sur demande unilatérale d’un conjoint, qui l’obtient automatiquement après 2 ans de séparation (depuis le 1er juin 2004 ; après 4 ans jusque-là).
A la fin du siècle passé, alors que l’on s’accordait déjà à admettre que la responsabilité de l’échec d’un couple ne pouvait être imputée à un seul des conjoints, même adultère, les avocats plaidaient généralement que les conjoints s’étaient à ce point éloignés l’un de l’autre que la poursuite de la vie commune n’avait plus de sens, justifiant la rupture du lien conjugal. On passait ainsi du « Verschuldensprinzip » au « Zerrüttungsprinzip ». L’incapacité à rester en lien, à s’adapter aux métamorphoses de chacun dans le couple, suffit désormais à justifier le divorce ; c’est prendre en compte la sclérose des cœurs, leur incapacité à se dilater…
Christine Habermacher-Droz / février 2025