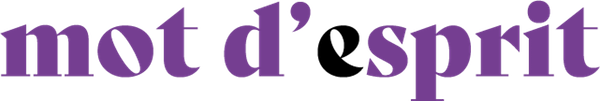Essai sur une évidence qui suscite au moins une question
à propos de la lecture de la parabole des talents (Mt 25 / 14 – 30) que Marie Balmary analyse dans un chapitre de
« Ce lieu que nous ne connaissons pas » – 2024
sous le titre Les mathématiques du royaume. – pp 39 à 78 –
Club Cèdres. Mardi 19 novembre 2024.
Comment se fait – il qu’à l’invitation jubilatoire du maître réponde une peur, celle du troisième serviteur, qui au – delà du récit, fascine, trouble et paralyse aujourd’hui encore, plus d’un lecteur, d’une lectrice ? Certes, il paraît que le cerveau humain est plus sensible aux faits négatifs que positifs. Mais au point de nous faire passer comme chat sur braise sur la joie qui anime les deux autres serviteurs, ce n’est pas sans conséquences.
Autrement dit, quels peuvent être les astres qui nous masquent si souvent l’étoile de Bethléem, comme s’ils avaient le pouvoir de changer notre joie en désastre ? Quel est donc cet objet d’origine céleste en apparence, capable de jeter une ombre si épaisse sur une joie pourtant reconnue comme imprenable (Lytta Basset) ?
Ou pour être tout à fait terre à terre, j’ai l’impression que des coulées d’habitudes de lecture ont recouvert le chantier de cette parabole, au point que nous avons mille peines à en percevoir la résonance et la pertinente actualité. Comme si l’enjeu qui concerne le développement du potentiel de chaque créature était subverti et bloqué au profit de la recherche… de quoi… au juste… d’une sécurité religieuse peut-être ? Mais alors au détriment de qui ?
C’est pourquoi avant d’aborder l’interprétation de la parabole selon Marie Balmary, je me propose d’attirer votre attention sur un de ces blocs de certitude rencontré lors de notre lecture commune précédente, mardi 29 octobre. Il s’agit du mot vedette « Tout ». En effet, dans les pages consacrées aux Noces de Cana, l’auteure nous avait mis sous les yeux ce fait troublant : dans les manuscrits grecs des Noces de Cana, très précisément dans l’ordre que la mère de Jésus donne aux serviteurs – Faites « Tout » ce qu’il vous dira – ce Tout n’existe pas. Un détail insignifiant pour les uns, une énormité pour les autres. Selon Marie Balmary c’est simplement une erreur. Comment est-ce possible ? A mon avis, les exégètes étant fait du même bois que le commun des mortels, ils ne sont pas d’une vigilance infaillible, donc pas à l’abri de ce phénomène qui veut que « plus c’est gros, mieux ça passe ».
Même si l’on rencontre la traduction « Quoiqu’il vous dise, faites-le » au lieu de « Tout ce qu’il vous dira », il y a encore une ambiguïté à lever, une sorte de subtile tentation totalitaire qui suit la lumière de l’Evangile comme son ombre. On la repère, par exemple, dans la scène du lavement des pieds quand Jésus répond à Pierre : « si je ne te lave pas [les pieds], tu ne peux avoir de part avec moi, et Pierre lui répond : « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ». Il est très humain ce désir d’avoir la casco totale. Les rédacteurs de cet Evangile ont conscience, me semble-t–il, de ce désir de totalité. On peut se référer aux chapitres 20 et 21. « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d’autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux–ci l’ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il me semble qu’on peut lire ici en filigrane que les auteurs sont libérés de ce désir de totalité. Si « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d’autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre » est – ce grave docteur, que nous n’ayons pas tous les signes ? non, un seul signe suffit déjà pour marcher dans la confiance en la parole de Jésus. Quand la joie survient, elle nous rejoint comme Jésus rejoint les Compagnons d’Emmaüs au cœur de leur abattement. Cette même joie commande aussi la dynamique de la minuscule parabole du trésor caché dans le champ. (Mt 13 / 44) Car ici également, la joie est aux prises avec l’humaine tentation du désir d’avoir la totale. Cela peut se lire même au ras des manuscrits en compagnie du théologien suisse Hans Weder, qui scrute les résurgences du légalisme au cœur même de l’Evangile, dans un chapitre intitulé « De la loi à l’Evangile » (dans « Quand interpréter, c’est changer » pp 55-75 P. Bühler et C. Karakash. Labor et Fides). Voyez plutôt.
« La seigneurie de Dieu est semblable à (l’histoire d’) un trésor caché dans un champ, qu’un homme a trouvé et caché (à nouveau) ; et dans sa joie [littéralement à partir de sa joie] il s’en va et vend ce qu’il a et achète ce champ. »
Or, ce n’est pas ce que vous lisez dans les Bibles traduites en français. Pour autant que je sache, vous trouvez ceci : « et dans sa joie, il s’en va et vend tout ce qu’il a. »
Ce que je trouve passionnant dans cette parabole, c’est que ce goût pour la totalité, – qui à mon sens cache mal l’idéal de perfection, qui est une perversion de l’Evangile (Bernard Rordorf), – ce que je trouve passionnant donc, c’est de constater que ce goût pour la totalité se manifeste déjà lors de la transmission de cette parabole. Il y a en effet une série de manuscrits qui comportent ce « tout ce qu’il a » et une autre série qui ne comportent pas ce « tout ». Il revient donc au lecteur et à la lectrice de choisir son camp. Quelle est la différence, qu’elle est l’enjeu, quelles conséquences pratiques pour nos vies ? Énorme, à tous égards. C’est comme à ski, quand on met son poids sur un pied ou sur l’autre. Si nous mettons notre poids sur « à partir de sa joie il vend ce qu’il a », nous sommes dans la dynamique des compagnons d’Emmaüs : la découverte, l’irruption inattendue de la présence vivante du Christ à leur côté suscite en eux, une énergie qui les remet en route vers le lieu de leur plus grande désillusion. Cette joie qui s’est emparée d’eux sera désormais la source de ce qu’ils vivront et entreprendront au nom de Jésus-Christ. Mais si nous mettons notre poids sur « il s’en va et vend tout ce qu’il a », les ennuis vont commencer. Écoutons Hans Weder : « Le sommet du légalisme est atteint lorsqu’il ne s’agit plus seulement de renoncer aux biens par un acte éthique héroïque, mais d’y renoncer avec joie et de faire le bien avec zèle. La joie de la découverte est remplacée par le renoncement pratiqué avec joie. La pensée légaliste redoute ce sur quoi elle n’a pas prise. C’est pourquoi elle préfère le renoncement joyeux au trésor qui rend joyeux.
« A partir de sa joie » désigne l’unique source de l’action de cet homme ».
« Et l’histoire de l’heureuse découverte fait apparaître explicitement que tout ce que le découvreur fait, il le fait par joie. La joie est le phénomène où se rejoignent l’action du découvreur et l’œuvre de la seigneurie de Dieu. C’est dans la joie que le règne de Dieu détermine le comportement de l’être humain ».
Choisir entre « …il vend ce qu’il a » et « il vend tout ce qu’il a » n’est donc vraiment pas anodin pour une autre raison encore : lorsque quelqu’un déclare que dans une situation difficile, il a fait tout ce qu’il a pu, au lieu de ce qu’il a pu » n’ouvre t-il pas la boîte de Pandore de la culpabilité dans laquelle le serpent se tient tapi avant de siffler : es-tu certain que tu as vraiment fait tout ce que tu as pu ?
A chacune et chacun de décider s’il s’agit d’une joie qui s’empare des chercheurs et des chercheuses de trésor que nous sommes ou s’il s’agit d’une joie que l’être humain peut se procurer à partir de ses propres ressources.
Bref, pour conclure provisoirement, j’espère qu’il vaut la peine d’essayer de tracer un chemin de lecture pour échapper à la fascination du trou creusé par le troisième serviteur. Car je n’ai pas envie, à travers une lecture convenue de la parabole d’assister, une fois de plus, non seulement à l’enterrement du talent de ce malheureux serviteur, mais aussi à celui de nos propres énergies créatrices. Même et surtout si je crois que Dieu ne laisse pas sa joie s’enterrer bien longtemps… Trois jours…au plus…
Pierre – Alain Chappuis. D’après un texte présenté le 19/11/2024 et retravaillé le 27 juin 2025 à Blonay.