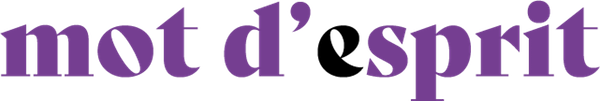Par René Blanchet.
Ce billet est dédié à toutes les personnes qui se posent la question d’un engagement écologique, spécialement aux participants du Club Cèdres, qui se réunissent mardi 17 juin prochain pour partager leurs pratiques, leurs projets ou leurs rêves d’engagement. Détails en fin d’article.
Dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’écologie, les bonnes nouvelles sont souvent contrées par de mauvaises ; l’enthousiasme suscité par les premières risque ainsi d’être étouffé par la déception que provoquent les deuxièmes. Nous savons, par exemple, qu’en Allemagne, grâce à un prix d’achat de l’électricité garanti par l’Etat, le nombre de panneaux solaires a crû énormément, jusqu’à assurer une puissance de 34 gigawatts. Mais cela n’empêche pas le gouvernement de renforcer la filière des centrales au charbon, dans laquelle des groupes suisses de producteurs d’électricité n’ont pas hésité à investir. Par ailleurs, le président Barak Obama vient de prendre une décision courageuse en annonçant des mesures destinées à diminuer la production de CO2 des centrales au charbon de 30% d’ici à 2030. Mais il avait également proposé à l’Europe d’acheter le gaz et l’huile de schiste que les USA se sont mis à exploiter, avec la pollution des terrains que cela occasionne. En Suisse et dans les pays alentour, la culture biologique fait des progrès réguliers. Les cours et rencontres consacrées à la culture bio font salles pleines. On constate cependant une augmentation alarmante de l’obésité dans la population, signe de mauvaises habitudes alimentaires. Pire encore, des groupes financiers mettent maintenant la main sur le marché bio en abusant des labels et de leurs principes.
On pourrait continuer longtemps d’énumérer ces nouvelles contradictoires, et il y aura, sans aucun doute, toujours matière à le faire. Ce qui génère une question qui doit inquiéter toute personne convaincue par les objectifs écologiques et durables : vaut-il alors la peine de s’engager ? Face à des comportements si versatiles, en butte à une résistance inventive et coriace, n’est-on pas perdant dès le départ ? Y a-t-il un sens à travailler pour des buts idéaux à long terme, quand l’opposition ne cesse de promouvoir des objectifs à court terme, pour le profit ? Ces questions nous obligent à réfléchir sur le sens même de l’engagement.
C’est, d’abord, faire un pari : pour un avenir possible, contre la fatalité. En nous engageant pour la cause écologique, nous ne comptons pas sur des victoires automatiques, mais nous postulons sur le fait qu’aucune situation n’est définitivement bloquée. Le présent n’est pas verrouillé, mais il s’ouvre sur des futurs que nous avons vocation à organiser et à aménager. Les chrétiens sont particulièrement interpellés, eux qui ont reçu de la part du Christ un message de changement et la proclamation de l’instauration du Règne de Dieu. Nous ne sommes pas enfermés dans l’instant. Le temps est en germination continuelle et, malgré les intempéries, des récoltes mûrissent. L’engagement est donc une manière d’anticiper l’avenir, en désacralisant le présent et en dés-absolutisant le passé. Il est nourri par une espérance. C’est précisément sur ce terrain du temps dynamique qu’il peut obtenir des victoires, avec de plus faibles moyens.
Si tout engagement commence par une décision individuelle, l’avantage est à la coopération. En s’adjoignant à des groupes ou des associations qui visent les mêmes objectifs, les personnes qui désirent s’engager trouvent un think tank, un réservoir d’idées, propre à les stimuler et les perfectionner dans l’action, ainsi que des collègues qui leur rappelleront le principe de réalité. Ce partage d’idées et de forces est important, mais il reste insuffisant. L’essentiel réside dans une responsabilité effective de la part des personnes impliquées, c’est-à-dire sans la prise en charge personnelle de la cause ou de l’action. La responsabilité est le nerf de l’engagement, la première des capacités, sur laquelle reposent toutes celles qui peuvent être utiles. Ceux qui éprouvent des craintes ou des sentiments d’infériorité quant à leurs aptitudes ne devraient pas l’oublier. L’apôtre Paul écrivait (2 Corinthiens 3,5-6) que ses capacités et celles de ses collaborateurs venaient de Dieu, qui les avait rendus capables d’être serviteurs de l’Alliance nouvelle. Il incluait, j’imagine, le sens de la responsabilité. Nous avons besoin du regard amical de l’autre qui nous reconnaît dans nos compétences. Nous pouvons être plus solides et plus déterminés en nous fondant sur l’aide de Dieu.
La responsabilité implique que l’on soit affecté par le problème dont il est question, afin qu’il nous devienne intérieur. Les pratiques non respectueuses de l’environnement créent de l’injustice et font des victimes : elles suscitent notre compassion et un sentiment de solidarité. A l’aspect émotionnel doivent cependant succéder l’analyse rationnelle de la situation et un jugement de valeur. Emotion, raison, décision : ces trois éléments n’opèrent pas qu’une fois, au commencement du processus. Ils sont sans cesse à reprendre au cours de l’engagement pour corriger un cheminement au trajet inévitablement tortueux. L’empathie doit donc générer une éthique du « je me suis fait tout à tous » à la manière de Paul (1 Corinthiens 9,19ss). Elle nous permet de comprendre les questions réelles et de sortir des clichés.
Les données sociologiques, économiques, politiques sont évidemment capitales pour nous aider à avoir des idées claires. Mais on sous-estime, même chez les chrétiens, l’apport que peut apporter la Bible et la théologie qui l’interprète. Il n’y a pas plus fort, aujourd’hui encore, pour nous rappeler ce qui fait notre humanité, pour remettre en ordre notre échelle de valeurs, pour dissoudre les idoles, pour nous réorienter vers ce qui nous transcende, nous et notre action : la grâce et l’amour de Dieu. Comment, sans elles, pourrions-nous nous relever de nos échecs et de la culpabilité qu’ils engendrent, comment pourrions-nous nous maintenir dans l’éthique de la simplicité, du don, de la joie anticipée du Royaume ? Nous subissons la tyrannie des médias qui jugent tout à l’aune de performances bien visibles. Mais pour durer dans l’engagement, nous devons croire aux forces de propagation invisibles, aux transformations lentes et imperceptibles des esprits, à la résultante encore cachée d’une multitude de petites actions. Tout engagement est prophétique, sa forme est la prière, qui veut faire advenir l’accomplissement dans l’inaccompli.
Le Club Cèdres
Mardi 17 juin 2014, Cèdres 5, 1004 Lausanne
18h30-21h30, (pique-nique canadien)
Partage de nos engagements, projets ou rêves écologiques.
Décisions quant à notre programme futur
Entrée libre
www.cedresformation.ch/le-club.html