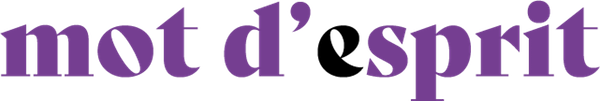UNE SYNTHÈSE : MARIE BALMARY
ET L’APPLICATION DE LA PSYCHANALYSE AU TEXTE BIBLIQUE
La manière dont deux disciplines différentes, comme la psychanalyse et la théologie peuvent collaborer ne va pas de soi. La théologie se réfère à Dieu et vise une rédemption due à l’action de l’Esprit saint ; la psychanalyse travaille à partir de l’inconscient sur des forces psychiques dont le déséquilibre aliène les humains et dont elle cherche à les guérir. La différence dans les finalités et les méthodes entraînent des problèmes et des ambiguïtés, même si l’objet humain est commun à leur attention. J’ai été intéressé par un article du théologien Guilhen Antier, dans la revue ETR 2024/4 (note 1), qui distingue trois lieux et modalités d’articulation entre psy et théol : 1) la discipline, ici la religion, la théologie. 2) le corpus, ici la Bible. 3) la méthode, le chemin à suivre. C’est selon ces trois niveaux que je reviens sur la manière dont Marie Balmary applique la psychanalyse au texte biblique.
1) La religion
On sait que Freud considérait la religion comme une illusion névrotique, responsable majeure d’une répression de la sexualité. Il s’empare pourtant des grands mythes et personnages bibliques pour les assujettir au mécanisme de l’inconscient et du Surmoi, du désir de vie et de mort. Ce n’est que vers 1970 (si l’on fait abstraction de l’échange épistolaire entre le pasteur Oskar Pfister et Freud) que les théologiens passent la frontière de l’athéisme freudien et entrent en dialogue avec ses idées. Toute autre est évidemment l’attitude de Marie Balmary : dans une interview du Temps (2), elle déclarait que « Freud pensait que la religion était ennemie du désir, qu’elle obligeait à y renoncer. Pour ma part, je vois dans le désir aussi ce qui pousse l’être humain vers l’infini, ce qui lui permet de ne pas se voir plus petit qu’il n’est. » Et plus loin : « Je dirais que la Bible est une gigantesque station d’épuration de la parole. Les textes bibliques attrapent nos maladies, mais en y regardant de près, ils nous donnent aussi les moyens d’en sortir…» Dans sa lecture, Dieu « devient un Dieu non total, qui refuse de prendre la place de l’autre.» Au contraire de nombre de psys qui considèrent la religion chrétienne comme fondamentalement aliénante, Balmary y décèle un programme d’éveil à l’humain.
2) Le corpus, la Bible
Mais c’est surtout sur le corpus, à savoir le texte biblique, que Balmary a appliqué ses analyses. De même qu’il s’agit, en freudisme, de déceler le texte caché dans l’inconscient et qui agit à notre insu (le texte est l’Autre inscrit en nous, selon Lacan), Balmary s’attache à des détails du texte biblique pour révéler les ressorts cachés du comportement de ses personnages humains ; et aussi, en conséquence, de l’action divine. Ces détails sont pour elle comme des failles qui lui donnent entrée dans les souterrains du texte. Ce qui lui permet de proposer des interprétations originales des récits. L’attention aux particularités du texte, de sa parole, caractérise l’approche des psy de la ligne freudienne et lacanienne (Françoise Dolto, Antoine Vergote, Louis Beirnaert, Marie Balmary, etc), alors que les jungiens ont du texte biblique une approche plus globale, allégorique, symbolique (Eugen Drewermann, Paul Tillich, etc).
Quant à Balmary, c’est la relation entre les personnes, la relation à soi, et leurs accidents, qui sont au cœur de son intérêt. Ayant acquis la connaissance de l’hébreu et du grec, Balmary n’hésite pas à faire œuvre d’exégète en proposant de nouvelles traductions, parfois pertinentes, parfois forcées. Bien qu’ayant l’intelligence de l’ensemble des textes, elle en fait une lecture sélective, orientée, correspondant à ses objectifs de psy. A cet égard, le théologien se sent parfois frustré, quand il a l’impression que la raison théologique, pour lui première, est minimisée face à l’explication psychologique. Il importe surtout à Balmary de bloquer toute interprétation exclusivement morale, pour mettre en évidence le retour à soi du sujet, à son autonomie, ainsi que la lui révèle l’expérience des personnages bibliques. Elle insiste sur leur dignité retrouvée ou à recouvrer, sur la destination de la filialité divine promise à tous les humains. Alors que le texte biblique peut apparaître étranger à beaucoup de gens, la vertu de l’approche de type Balmary, est de le rendre actuel et universel en faisant ressortir sa fondamentale humanité.
3) La méthode, le chemin à suivre
Finalement, Balmary joue sur la convergence entre la méthode psychanalytique qui tente de sortir le patient de sa névrose, et l’action de la grâce qui libère du péché celui qui se confie à elle. Pour elle, de fait, le processus psychologique est inclus, bien qu’invisible la plupart du temps, dans l’action libératrice de la parole divine. Il est une de ses dimensions. Certains y décèleront un danger de confusion entre l’analyse psy et la spiritualité chrétienne.
Il résulte de la perspective de notre auteure la découverte d’un chemin personnel pour chaque lecteur ou auditeur de la Parole : non pas obéir, ni être soumis (au Surmoi, à une autorité extérieure), mais être attentif au mouvement de son désir qui tend à la liberté, à être soi; accepter le don venu de Dieu ou d’autrui, faire confiance et manifester sa reconnaissance ; ne pas vouloir être parfait, mais faire place à l’autre ; aimer, comme Dieu aime. Balmary adhère à la pédagogie de l’engendrement que contient l’Évangile (elle cite Christoph Théobald) (3) ; il ne s’agit pas d’une incitation à la morale, mais de travailler à une naissance à l’humain, dans la lumière de Dieu.
René Blanchet, 16 juin 2025