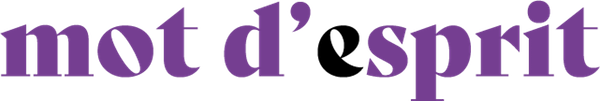L’ÉNIGME MARIE-JOSEPH
Réalisée par des participants du programme 2024-2025,
une analyse d’un chapitre du livre de Marie Balmary,
Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. A la recherche du Royaume.
Albin Michel, 2024, pages 155-181
Le thème de l’inconnaissance qui parcourt ce chapitre oblige à une attitude de respect, d’accueil et d’écoute dans les relations humaines.
Pour M. Balmary, manger est l’acte le plus dé-différenciant qui soit, ce que je mange devenant partie intégrante de moi. À distinguer de l’emprise ou de la fusion. Comment comprendre alors l’eucharistie que l’on ingurgite ? C’est la relation qui est porteur de sens. Avec Christ Jésus. Avec l’autre qui partage le pain avec moi. Quand Jésus prononce « ceci est mon corps » – to soma – en grec, to est un neutre qui se traduit par ceci. Par là-même est nommé le tout de la relation. Il ne faut pas chercher à trop préciser mais accepter de rester dans l’inconnaissance. Le littéralisme est une déviance. Cette précision de genre permet de déduire que les contemporains des évangélistes faisaient une lecture symbolique de l’eucharistie, sans quoi un autre pronom démonstratif aurait été utilisé.
« Concernant la conception de Jésus, les protestants n’ont pas le poids de la virginité, dit l’un d’entre nous. Dans ma foi, il fallait un père et une mère. On a tiré Jésus hors du domaine humain pour aller vers le divin. Je préfère voir en Marie une personne en possession de son être intérieur et extérieur, qui ne se laisse pas commander, même par Dieu. Marie Balmary démythologise, démythifie. » Parler de Marie en disant « la jeune fille au cœur pur » simplifie tout en étant correct par rapport au mot employé la désignant. Cependant, on veut garder aussi le lien avec l’histoire évangélique, même si l’on est conscient que nous ne pouvons la reprendre à la lettre pour une question de bon sens. En démythifiant, on risque d’insécuriser. Notre souci n’est pas de valider tel quel ce qui a été exprimé à l’époque, mais de trouver les bons mots pour formuler l’expression de la foi. Notre génération posait les questions en Vrai ou Faux. Comment lire l’Écriture ? La lecture symbolique semble désormais acquise. Sortons du littéralisme. Il n’y a pas de contradiction entre ces deux modes de lecture pour autant qu’on recherche le sens qu’a voulu donner l’auteur.
On ne peut jamais posséder l’autre: la création d’Ève pendant le sommeil d’Adam, l’humain, l’illustre. Le récit montre qu’ils seront à jamais dans l’inconnaissance l’un de l’autre. Cette réalité de notre condition est à comprendre et accepter.
Dans ce chapitre, Marie Balmary a voulu montrer la progression de la relation dans les trois couples qu’elle a commencé à analyser dans La divine origine. « Nous » est divin. Le couple aussi. Partant d’Adam et Ève, puis d’Abraham et Sarah, elle arrive à Joseph et Marie qui ont su s’unir dans l’inconnaissance.
Tant qu’Adam est seul, il n’y a pas d’histoire. Le « Je » implique un Tu, qui est autre. Encore l’inconnaissance. Quand Dieu dit : « Tu ne mangeras pas », un interdit est certes posé, mais ce n’est pas un dialogue. Le sujet n’est pas encore apparu. Par ce constat Marie Balmary évacue la notion de péché originel, car Je n’est pas encore advenu. Cette transgression n’est pas sans conséquence : par la perte de cette inconnaissance, Adam et Ève se privent de l’accès au processus de divinisation auquel nous sommes tous appelés. L’image de Dieu entre eux n’est pas apparue, souligne Balmary (p. 163). Ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire. Ils constituent un couple boiteux. Ils ne seront plus égaux. La peine consistera à enfanter dans le chagrin.
La première évolution se fait à travers Abraham et Sarah. Là ou une vraie maternité et une vraie paternité s’exercent, comme exposé dans le chapitre « Un homme avait deux enfants ». Marie Balmary nous donne des clés de lecture sur cette non-appropriation de l’autre. Ce détachement permet l’établissement d’une relation à juste distance. Amener l’autre à être libre. Dans ce couple symbolique, la relation progresse par la circoncision et l’Alliance. Il n’est pas écrit « Abraham connut Sarah. » Souvent son rire est considéré comme péché. Balmary renverse cette interprétation : en affirmant l’autonomie de l’être humain qui doute, en montrant son humanité, le sujet indépendant apparaît. Le rire de Sarah est bon signe. L’enfant n’est plus celui de la peine, mais le fils du rire. Ce couple fonctionne malgré le dis-fonctionnement d’Abraham ayant encore dans le cœur le dieu mangeur d’hommes.
Joseph et Marie ne sont pas si drôles, mais ceci est une autre histoire. Une des raisons de la désaffection de nos Églises est de ne pas avoir adapté notre langage. Pourtant, la dialectique rire/religion est porteuse, on vient de le voir. Comment montrer une image joyeuse de la foi ? On a trop mis le poids sur notre péché et notre nullité. Marie Balmary ne sacralise pas le couple. En le confondant avec un idéal éthique, on a sacralisé l’idéalisation. D’une situation non conformiste, Joseph et Marie ont pu bâtir une relation qui progresse, qui fait couple. L’engendrement est raconté comme accomplissement de la promesse.
À nous aussi de vivre cette forme d’inconnaissance. Peut-être rejoignons-nous là le titre de notre livre « Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas ». Ce lieu non connu n’aurait-il pas à voir avec la présence d’un Dieu en nous qui nous enseigne ? Un Dieu qui engendre en nous quelque chose qui nous dépasse. Comment cette phrase me parle-t-elle ? Comment la vivre dans la relation à l’autre ? Écouter l’autre pour ce qu’il est. Balmary essaie de décrire cette inconnaissance ontologique. Une participante témoigne : « Au moment de la naissance de mes enfants, j’ai vécu ce lieu que je ne connaissais pas ».
L’homme ne comprend jamais complètement la femme, et vice versa. Ceci est valable pour toute relation. Il faut accepter cette part de mystère en l’autre. Et aussi celle en nous. Notre mission n’est-elle pas de devenir soi ? Certes, mais ce n’est jamais définitif. S’accepter soi-même, c’est accepter d’être engendré. Il ne faut pas limiter notre vision sur la différenciation exclusive homme/femme. L’acceptation d’une part d’inconnaissance en nous ouvre aussi la porte du Royaume.
Hugues de Lagarde, rédacteur, en collaboration avec Monique Bassin, Christophe Büchi, Cynthia Defago, Pierre-André Diserens, Alain Cauderay, Eva Brunisholz, Marc-E. et Anne-Marie Diserens.