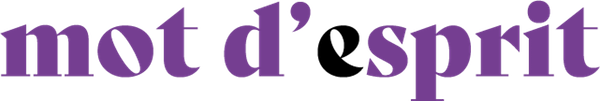UN HOMME AVAIT DEUX « ENFANTS »… (Mt 21, 28-31)
Réalisée par des participants du programme 2024-2025,
une analyse d’un chapitre du livre de Marie Balmary,
Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. A la recherche du Royaume de Dieu
Albin Michel, 2024, pages 25-30.
Le texte
Je ne vais pas relire tout le texte ; je vous rappelle seulement que les juifs demandent à Jésus: « De quelle autorité fais-tu cela ? » Jésus leur pose alors la question : le baptême de Jean, d’où venait-il ? Comme ils ne répondent pas Jésus refuse de leur répondre et préfère raconter la parabole dite des deux fils :
28 Un homme avait deux fils (enfants). S’avançant vers le premier, il lui dit: “Mon enfant, va donc aujourd’hui travailler à la vigne.” 29 Celui-ci lui répondit : “Je ne veux pas” ; un peu plus tard, pris de remords (il change d’avis), il y alla. 30 S’avançant vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit : “Moi, Maître (=J’y vais, Seigneur); mais il n’y alla pas. 31 Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » — « Le premier », répondent-ils. Jésus leur dit : « En vérité, je vous le déclare, collecteurs d’impôts et prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu.
Méthode Balmary
Balmary est systématiquement très critique avec les traductions. Elle constate qu’à partir d’un texte original, en grec mais surtout en hébreu, très difficile à traduire ou même à comprendre, les théologiens proposent une traduction parfaitement claire mais qui va dans le sens de leur théologie. Quand elle s’attaque au texte de la genèse, elle constate par exemple que tous les textes en français vont dans la direction d’une faute initiale dont l’homme est responsable. Elle s’attache alors à montrer, en reprenant mot à mot le texte en hébreu, qu’il s’agit d’une erreur de traduction. Dit autrement, les théologiens étant formatés par le concept du « péché originel », ne peuvent que le trouver quand ils traduisent la Genèse.
Il me semble pourtant qu’en ce qui concerne les évangiles, cette approche, très critique dans le cas de la Genèse, est moins efficace, disons moins révolutionnaire. Particulièrement dans le cas de cette parabole, je n’ai pas trouvé que le remplacement de fils en enfants ou l’introduction du mot père changent radicalement les choses.
Toutefois Balmary est aussi une psychanalyste et c’est aussi en psychiatre qu’elle va se demander pourquoi ces deux enfants ont un tel comportement : pourquoi le premier, l’aîné (?) refuse-t-il d’aller dans la vigne et finalement y va, alors que le second accepte d’y aller, mais n’y va pas ?
Interprétation habituelle…
Sur le web, j’ai trouvé un certain nombre de prédications concernant ce texte, une dizaine de prédications et d’homélies. Je qualifierai leur approche de moralisante : ce n’est pas le « dire » qui compte mais le « faire » et en général on cite tout un tas de texte qui vont dans ce sens. Par exemple, Matthieu 7,20 : « C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Ceux qui me disent : « Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le Royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ».
Par contre, on trouve une exégèse très curieuse, qui semble remonter à St Hilaire de Poitiers, qui affirme que c’est le deuxième enfant qui est dans le juste, donc celui qui a dit oui et qui n’a rien fait, et que c’est à lui que sont associés les collecteurs d’impôts et les prostituées…
Psychanalyse et souvenirs personnels
Je reviens à Balmary qui, refusant l’approche moralisante, cherche à faire une psychanalyse des deux enfants afin de comprendre leur réponse. Elle remarque tout d’abord que ce n’est pas n’importe quel travail : il faut aller travailler la vigne, la vigne étant le lieu par excellence du travail heureux : Noé plante une vigne après le déluge ! Ici, elle représente peut-être le royaume de Dieu.
Le premier enfant refuse car il ne veut pas obéir à un maître: c’est l’autorité du maître qui est rejetée. En revanche, après coup, il pense à la vigne et c’est par intérêt pour la vigne qu’il va y travailler.
J’ai beaucoup réfléchi à cette interprétation et j’ai cherché à me remémorer des moments où j’aurais pu me trouver dans la même situation.
J’étais à un cours de répétition en simple trouffion et marchant à côté d’un officier, celui-ci m’a dit : portez ma serviette. J’ai répondu: non !
J’avais, disons 14 ans, et mes parents tenaient un commerce, une laiterie-épicerie, et un samedi après-midi, mon père me dit : J’aimerais que tu viennes au magasin, j’ai du travail pour toi. Je n’aurais pas osé lui répondre brutalement : non ; je lui ai dit: Non, car j’ai des leçons à préparer pour l’école. Mon père ne pouvait s’y opposer. Ayant terminé mes devoirs, je suis descendu au magasin et j’ai demandé à mon père ce qu’il voulait que je fasse…
Le premier enfant n’obéit pas. Il ne se situe pas comme serviteur d’un maître, c’est absolument le sens de mon refus au lieutenant. Quant au refus à mon père, je considère que faire mes leçons est plus important que d’obéir. Après, il change d’avis et je change aussi d’avis, réalisant que le bon fonctionnement du magasin, c’est aussi mon intérêt.
Balmary écrit : « L’enfant ne tue pas le père, il tue le maître dans le père, et le père le laisse faire. C’est en cela qu’il est père. Son désir n’est pas d’être obéi aveuglément, mais que l’enfant advienne (…). Refusant le maître, l’enfant a trouvé le père. La volonté d’un maître est que le serviteur obéisse. Le désir d’un père, c’est que l’enfant advienne, non pas comme serviteur, mais comme fils ! » (pages 28-29).
D’où la réponse concernant l’autorité : « De quelle autorité fais-tu cela ? ». Réponse : « De l’autorité souveraine du fils ! ».
Le second accepte d’obéir au maître, mais pourquoi n’y va-t-il pas ?
En songeant à ma petite enfance, je retrouve des souvenirs analogues. À la même injonction paternelle, il m’arrivait parfois de répondre « Oui » et de me défiler, préférant aller jouer. L’interprétation de Balmary apporte un éclairage sur cette situation : la parole que ce second enfant entend, il ne peut pas la faire sienne, car il ne peut pas la défaire, il ne peut pas se l’approprier. Elle demeure celle de l’homme qu’il appelle « maître ». Il reste collé à lui. Aller dans la vigne n’est pas son désir et cela ne peut pas devenir son désir s’il reste à cette place. Or, sans désir, pas d’énergie. C’est, paradoxalement, parce qu’il entend cette parole comme un ordre qu’il ne peut l’accomplir.
Quand Jésus a-t-il dit non ?
Contrairement à St Hilaire, Balmary a clairement choisi le premier comme étant celui qui agit avec justesse. C’est au moment où il va dans la vigne qu’il découvre qu’il n’a plus un maître, mais un père. En songeant alors à Jésus, elle se demande quand ce dernier a dit non, a « refusé d’aller à la vigne ». Elle pense tout d’abord à Jésus à 12 ans, lorsqu’il n’a pas suivi ses parents…, afin d’accomplir ce pour quoi il se sent appelé. Dans le judaïsme de l’époque, 12 ans, c’est l’âge où l’on devient un adulte ! Mais elle pense aussi à l’attitude de Jésus après son baptême par Jean-Baptiste. A cette occasion, Jésus entend cette parole : « Celui-ci est mon fils bien aimé (…) », mais au lieu de s’occuper de la vigne, des « affaires de son père » (du royaume de Dieu…), il dit non en partant jeûner 40 jours. Il part dans le désert et affronte ses doutes sur sa filiation : « De quel père suis-je le fils » (p. 30) ? Finalement Jésus démasque le Satan et débutera son ministère avec du vin, au mariage de Cana.
Conclusions personnelles
A qui doit-on obéir ? C’est au fond l’enjeu de cette parabole ? Suis-je passé à côté de mon « moi » authentique ? J’ai été un enfant, j’ai subi l’influence des parents, des amis, de la société ambiante. J’ai nourri diverses ambitions, et certains événements m’ont marqué et façonné. Mais je me pose toujours cette question : ai-je vraiment fait ce que je devais faire ? ai-je osé dire : oui ou non !
« Va vers toi-même ! », dit Dieu à Abraham. Je ne crois pas que la quête pour «changer» puisse s’arrêter un jour. On marche vers l’authenticité en mourant un peu chaque jour à ce qui est inauthentique en soi, en repérant nos différents «mensonges». Il y a toujours une vocation tardive qui nous attend. C’est ce que symbolise l’enfant de la parabole qui a d’abord dit non, puis se re-prend, change d’avis et dit maintenant oui à ce à quoi il est appelé. Dans le fond, c’est un immense message d’espoir : il n’est jamais trop tard pour changer et devenir soi, et connaître le bonheur indicible d’être bien dans sa peau, de rayonner de vie. C’est ce que Dieu attend de nous.
Question pour la discussion :
Que fait-on aujourd’hui des prostituées et des collecteurs d’impôts ?
Willy Benoit