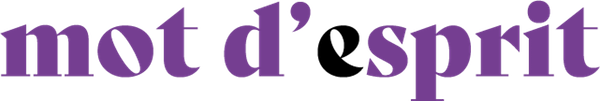Il suffit que nous soyons un peu en hauteur pour être émerveillés par la mosaïque printanière que nous offre la campagne. Le dessin géométrique des champs de colza est en train de s’atténuer, mais il est relayé par le vert tendre et le vert-bleu des blés qui s’élèvent rapidement. Encore une fois, je me suis demandé pourquoi un tel paysage nous plaisait et nous réconfortait si fort, pourquoi il pouvait même infuser en nous le sentiment du sublime, en sorte que nous le trouvons « beau ».
La réponse repose sur des éléments subjectifs, qui ont cependant un ancrage dans le réel. Les tons vifs et clairs nous confirment la fin de l’hiver et symbolisent la vigueur retrouvée du vivant. Mais, à cette première émotion s’ajoute une réaction à la fois plus abstraite et plus existentielle : nous sommes rassurés par la régularité, par la consistance de la géométrie du paysage ; cette géométrie nous garde de la peur du chaos, de l’indéterminé, de l’inorganisé, cet état hostile à la vie et vide de signification, absurde. Cet état, qui, selon le livre de la Genèse, précédait la création. La raison en nous, qui vérifie l’ordre et la différence existant dans le tableau de la nature, nous rappelle que nous vivons au-delà de ce chaos ; en résulte un sentiment de sécurité et de reconnaissance.
Cependant, les choses ne sont pas si simples : il existe une autre peur, entraînant du coup un autre besoin de sécurité : elle provient, à l’inverse, de la vision de ce qui est trop géométrique et trop symétrique. Un jardin à la française, une architecture contemporaine archi-rectangulaire peuvent provoquer en nous ce malaise : nous avons l’impression que là aussi la vie est exclue, tuée par le manque de différence, et comme par un excès de raison. La peur de la monotonie, de ce qui nous apparaît froid ou glacial, s’enracine dans la peur de la mort.
Nous désirons que notre existence soit à la fois structurée et ouverte, ferme et mobile, apte à intégrer et à donner. Et puisqu’instinctivement, en contemplant un paysage, nous établissons un rapport à notre existence, nous aimons à retrouver en lui les caractères qui nous semblent essentiels. C’est évidemment le travail humain qui les a transférés dans la nature, en sorte que notre contemplation a toujours quelque chose de narcissique. Impossible de nous débarrasser complètement de ce comportement, qui nous fait appréhender toute réalité selon la mesure humaine. Même face à une étendue désertique qu’aucune main n’a façonnée, une plaine de Mars ou la mer, nous projetons nos envies de voyageurs et notre exigence de synthèse et d’équilibre. Nous devons nous réjouir, je pense, de ce grand jeu de miroir qui nous redit le miracle de la vie et fait barrière contre le non-sens et le néant.
Par René Blanchet.